
Voici mon 6° et dernier envoi depuis Taïwan que je quitte lundi pour Hong Kong puis quelques autres étapes, avant mon retour en France en avril. Comme je vais être assez souvent en transit, je ne sais pas si je vais produire beaucoup d’autres lettres. Peut-être d’ailleurs porteront-elles aussi sur Taïwan car j’ai encore quelques impressions en stock…
En attendant une éventuelle suite, celle-ci est découpée en 8 séquences. Bonne lecture !
Les lanternes célestes de Pingxi
La fête des lanternes, 15 jours après le nouvel an chinois, vient en clore les festivités. Au nord est de Taipei, Pingxi, un ancien village minier, est réputé dans toute l’île pour ses lâchers de lanternes célestes.
[Pour visualiser le diaporama en grand format, cliquez sur la première photo]
Ces lanternes sont en fait des montgolfières miniatures. Elles s’envolent, propulsées par l’air chaud que produit le feu allumé à leur base. A la nuit tombée, elles dansent ainsi dans le ciel avant de retomber là où le vent les emporte. Comme la vallée est profonde et la forêt humide, nul incendie ne s’en suit.
Se mêle à cette tradition une croyance populaire : que les vœux rédigés sur les faces se réalisent. Aussi dans les rues qui longent la voie de chemin de fer d’où elles sont lancées, des échoppes vendent ces lanternes et fournissent des pinceaux pour rédiger souhaits et espérances. Même les couleurs ont une signification : le rouge pour la santé, le violet pour la chance aux examens, le rose pour une famille heureuse et prolifique, le bleu pour une vie professionnelle réussie, le violet pour l’amour, le vert pour des rêves qui deviennent réalité…
Mais ces lanternes avaient au départ dans cette vallée, un autre usage. Au XVIII° siècle, le grand banditisme sévissait dans la région. Les villageois utilisaient ces lanternes pour avertir de l’arrivée de bandes de brigands et permettre aux habitants de leur échapper en s’enfuyant dans les montagnes. Une fois le secteur pacifié, la tradition en est restée et connaît même aujourd’hui un véritable succès commercial…
Le charbon de Pingxi
Si les lanternes s’envolent, les hommes ont ici longtemps creusé le sol. En effet, au début du XX° siècle, du charbon a été découvert dans cette région de montagnes. Les Japonais qui alors gouvernaient l’île installèrent une ligne de chemin de fer dans la vallée afin de permettre l’évacuation des minerais. Les mines sont aujourd’hui fermées, mais elles sont restées en activité pendant plus de 60 ans et ont employé jusqu’à 4000 personnes. Pendant cette période, la ligne a aussi servi pour l’exploitation forestière :
Lors de mon passage à Pingxi pour la fête des Lanternes, une exposition photographique temporaire rendait compte de cette époque et de la nature du labeur. J’ai été frappé par l’histoire de ce territoire : de paisibles paysans ayant à faire face à des bandes de maraudeurs et de pilleurs, puis des manœuvres poussant des wagons et aujourd’hui le tourisme et des commerces de lanternes…
L’empreinte de l’homme
Le nord de l’île est très urbanisé. Taipei, la capitale et ses faubourgs, rassemblent 9 des 24 millions d’habitants de Taïwan. Mais elle est implantée dans une zone tropicale, très humide – en hiver, les jours sans pluie ou sans bruine sont rares –, au bord d’une rivière et de la mer où la nature prend rapidement ses aises.
La piste cyclable qui relie Tamsui, l’ancien port de Taipei, à la ville longe la mer. Sur de longs segments, elle est coincée entre la mangrove et une ligne de métro. En l’empruntant, j’ai été frappé par ce contraste entre une végétation capable d’envahir des espaces improbables et le béton – ferraille qui marquent notre territoire !
Le Parc national de Taroko
La côte Est de l’île fait face à l’immensité du Pacifique. Elle est plus sauvage, beaucoup moins habitée. J’y ai récemment fait un bref séjour et j’ai regretté de ne pas y être venu plus tôt. J’y serais sûrement revenu.
Dommage qu’un fichu vertige m’ait privé d’explorations et randonnées le long des pentes abruptes qui ici abondent : ce « sentier du vertige » par exemple, large de 70 centimètres au moment où il serpente sur une corniche, à 500 mètres au dessus de la Liwu ! Impossible aussi d’emprunter à Bulowan cette passerelle suspendue au dessus des gorges de Taroko creusées par la rivière sur 18 kilomètres. J’ai dû me contenter de randonnées plus modestes et d’un parcours en bus le long de la route qui remonte la vallée. Mais c’était déjà impressionnant et magnifique !
[Les carrousels n’autorisent pas l’alternance d’images horizontales et verticales. Du coup, voici celles en format portrait]
Une route construite avec « du sang, de la sueur et des larmes »
Jusqu’en 1960, aucune route ne permettait de relier l’ouest et l’est de l’île, à cause des massifs montagneux qui en occupe le centre. C’est Tchang Kaï-check, le potentat qui a régné d’une main de fer sur l’ile de 1949 à sa mort en 1975, qui a décidé d’en creuser une pour des raisons militaires : permettre en cas de tentative d’invasion de circuler rapidement d’un côté de l’île à l’autre. Il a fallu 4 ans d’effort, occupant chaque jour 4 à 5 000 ouvriers, pour creuser dans la montagne cette route de 190 kilomètres.
Ce sont des pancartes qui font face au Temple de l’éternel Printemps (photo 1) qui rendent compte des conditions dans lesquelles ces travaux ont été réalisés ! Les textes mélangent la fierté pour l’œuvre accomplie et l’effroi devant ses conséquences humaines : 226 hommes morts pendant les travaux. Ils rappellent que c’est en leur mémoire que le temple a été construit.
Comme pour le charbon de Pingxi, c’est finalement aux modestes qu’on demande de satisfaire nos besoins ou de payer le prix des ambitions ou des volontés belliqueuses…
Apprendre une langue vivante
J’ai le souvenir d’avoir appris pendant toute ma scolarité l’anglais comme une langue morte. Après 12 ans d’apprentissage, elle s‘était mise à vivre en quelques semaines de séjour dans un kibboutz où elle était la langue de communication entre tous les jeunes étrangers venus y travailler.
Rien de tel ne m’est arrivé ici, peut-être à cause de l’anglais d’ailleurs qui y est assez répandu et avec lequel je m’exprime plus aisément. En revanche, les méthodes utilisées sont bien plus stimulantes et efficaces que celles que j’ai connues en France : apprendre un dialogue par cœur et le jouer avec son voisin, écouter chez soi le vocabulaire et les phrases apprises 5 fois de suite, répéter les mots nouveaux et les phrases après le professeur qui vous corrige les erreurs de ton (il y en a 4 en chinois qui changent le sens d’une même syllabe) et de rythme d’élocution, rédiger un texte sur un sujet donné, le faire corriger, puis l’apprendre par cœur et le réciter, etc. Sans compter les tests chaque semaine pour vérifier les acquisitions, la compréhension orale…
Peut-être qu’aujourd’hui c’est ainsi qu’on enseigne les langues en France. Enfin, je l’espère…

[Cette photo d’illustration rassemble mes collègues d’apprentissage, venus pour l’essentiel d’Asie du Sud-Est : Thaïlande, Viet Nam, Singapour, Philippines, Indonésie. Deux exceptions : une Péruvienne et moi]
En chinois, le jeu des places
Dans une rédaction, j’ai cru écrire : « quand j’arrive à l’Université… » : dàxué dàole (大学到了). Robin, ma professeure, me corrige et inverse l’ordre : dàole dàxué. Je lui fais part de ma surprise et elle m’explique que j’avais écris que je venais d’arriver à l’Université comme si c’était un fait, alors que je raconte simplement ce que je fais habituellement.
En chinois, l’ordre des mots a une grande importance. C’est la contrepartie de ce que beaucoup interprètent comme une absence de grammaire : pas de conjugaison, pas de déclinaison, peu de prépositions, des actions qui s’enchainent comme des perles … S’il avait été Chinois, Molière n’aurait pas pu jouer sur la place des mots dans la déclaration d’amour du Bourgeois gentilhomme sans en affecter le sens !
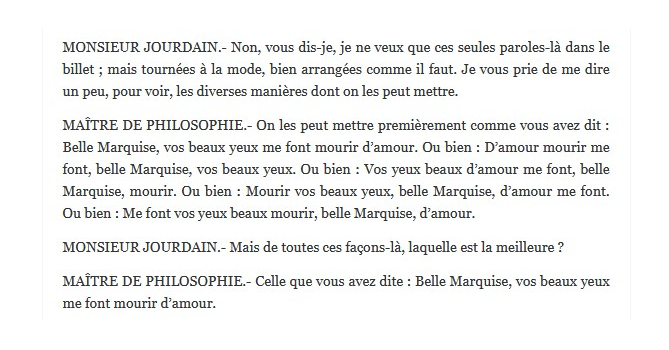
Cette rigidité syntaxique est difficile à intégrer. Je suppose qu’il faut acquérir une grande familiarité avec la langue pour s’y trouver à l’aise et pouvoir jouer en connaissance de cause des subtilités qu’elle rend possible. En tout cas, il ne faut surtout pas penser en français avant de parler !
