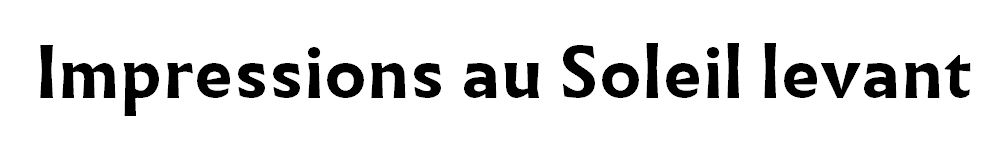Voici une 4° livraison (de 1/6 à 6/6). Bonne lecture !
La relève de la garde
La statue immense qui toise cette curieuse scène est celle de Sun Yat-sen. C’est un homme politique Chinois qui joua un rôle important au tournant du XIX° et du XX° siècle dans l’instauration d’une République chinoise. Mise en place en 1912 à la suite de la chute du dernier empereur Qing, il en devint le premier Président. Il a combattu jusqu’à sa mort en 1925 contre les Seigneurs de la guerre qui se partageaient et divisaient alors le pays, en faisant alliance avec les communistes lorsque ceux-ci apparurent sur la scène politique chinoise, dans la foulée de la révolution soviétique.
Je visitais l’immense mausolée qui lui est dédié à Taipei au moment d’une relève de la garde. Je n’avais pas prévu d’y assister, mais j’ai trouvé cette scène tellement étrange que je suis resté à la regarder et la filmer jusqu’à son terme. Je n’avais jamais vu utilisé un fusil comme un bâton de majorette ! Si ça pouvait toujours être comme cela qu’on s’en sert !
Éloge (mesurée) de la répétition
Ce matin, en allant à pied à l’Université, l’idée m’est venue qu’il était vraiment agréable de voyager sans bouger. En semaine, tous les matins, en bus, à pied ou en vélo, je me rends au Centre de langue chinoise, suffisamment tôt pour déguster un cappuccino dans un petit café qui lui fait face.
La routine, c’est l’assurance d’une tranquillité de l’esprit, une paix de l’âme, un confort. Mais si elle se met à régner sans partage, elle devient mortel ennui. Cela me rappelle ce que j’avais observé dans une chaîne d’embouteillage où une équipe, de temps à autre, laissait s’accumuler du retard pour rompre la monotonie de leur travail et relever le défi de sortir d’une situation compromise sans avoir à arrêter la chaîne et subir les reproches du contremaître. Comme les dynamiques du Yin 陰 et du Yang 陽 doivent se renverser nécessairement l’une dans l’autre pour que l’équilibre du monde soit respecté, ainsi devrait-il en être, je suppose, de la routine et de l’innovation.
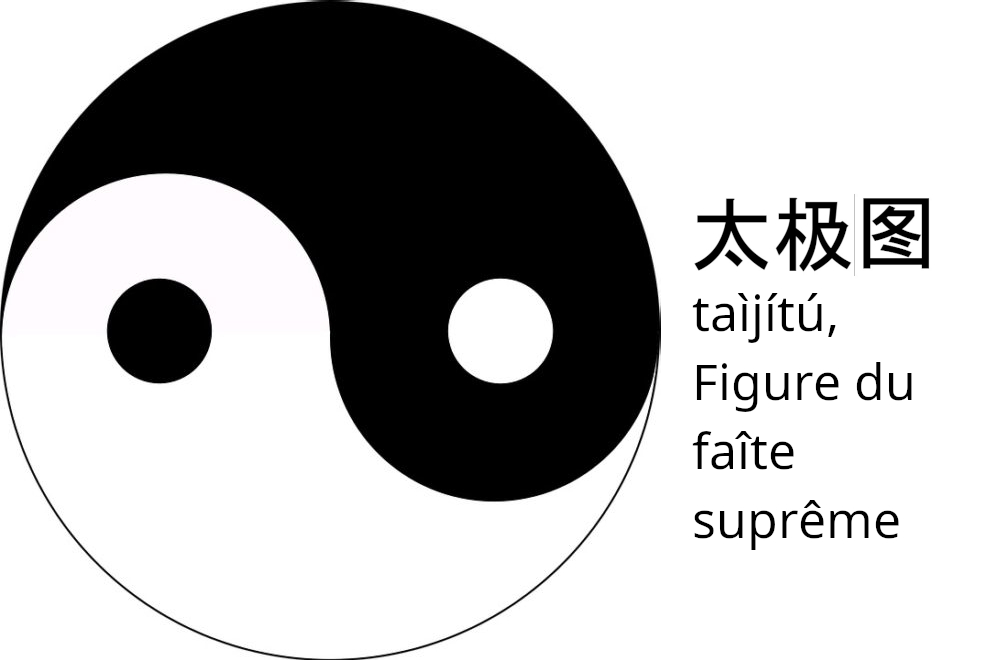
[Dans la pensée chinoise, le Yin et le Yang ne sont pas des états (féminin / masculin ; nuit / jour ; faiblesse / force ; froid / chaud…) comme on les présente souvent en occident, mais des mouvements complémentaires : tendance féminine / tendance masculine ; montée de la nuit / levée du jour ; affaiblissement/ renforcement ; refroidissement / réchauffement… Dans la Figure taoïste du faîte suprême (太极图 taìjítú) qui illustre ce texte, l’œil blanc dans le Yin noir et l’œil noir dans le Yang blanc signifient que l’un est déjà en germe dans l’autre. Le faîte suprême, c’est le sommet du toit, cette ligne critique où il bascule sur son autre versant, car jamais un versant, qu’il soit Yin (ubac) ou Yang (adret), ne monte jusqu’au Ciel ].
Des commerces essentiels…
A regarder le nombre de commerces dans les rues, l’alimentation doit être la préoccupation majeure des Taïpeiziens. Il y en a partout et de toutes formes : des restaurants à tous les coins de rue, des étals de viande, de fruits ou de légumes, des supérettes ouvertes tous les jours 24 heures sur 24… On mange bien – si on ne se trompe pas dans la commande… –, beaucoup et à n’importe quelle heure, pour seulement 2 ou 3 €.
[Pour visualiser le diaporama en grand format, cliquez sur la première photo]
Mais pas loin derrière viennent les scooters (diaporama ci-dessous). Ce sont eux qui s’élancent les premiers quand les feux passent au vert et qui à l’arrêt encombrent les trottoirs. Les piétons n’ont pas la priorité. Gare à eux, s’ils l’oublient…
Je me suis d’ailleurs rendu compte que les rampes d’accès sur les trottoirs que j’avais trouvé ingénieux et pratiques pour les poussettes ou les vélos (Lettre 2), servaient en fait surtout aux motos pour aller se garer…
De la laideur sans vergogne…
L’urbanisme à Taïpei a une structure simple, même s’il existe quelques variantes : de larges avenues (parfois vraiment très, très larges) parcourent la ville.

Elles sont bordées de commerces. D’elles partent des allées perpendiculaires plutôt résidentielles.

On n’est jamais très loin d’une voie principale où l’on trouve les arrêts de bus ou les stations de métro.
Là où j’habite par exemple, d’un côté, je dois marcher 50 mètres pour arriver à une rue commerçante et 100 mètres de l’autre pour rejoindre une voie importante, très animée.
Cette occupation de l’espace est plutôt ingénieuse. Elle permet de concentrer la trépidation de la vie urbaine d’un côté et de préserver un certain calme aux résidences de l’autre – au moins celles qui ne donnent pas sur ces avenues.
Mais alors, les façades, les bâtiments !


Poser ainsi côte à côte, des immeubles de taille, couleur, forme sans rapport les uns avec les autres et les laisser se dégrader avec le temps (ceci dit, le climat tropical, la pollution, les typhons et autre tremblement de terre ne facilitent pas leur préservation…) font de cette ville un concentré de laideur urbaine. Heureusement que les affichages multicolores ou la nuit viennent en masquer les détails. A l’aune de Taipei, Londres serait un joyau architectural ! Dès le premier coup d’œil, cela m’avait piqué les yeux, mais j’avais l’espoir que je découvrirais des quartiers ou des villes mieux lotis ; un espoir toujours déçu jusqu’à présent. Certes, l’intérêt d’une cité ne se résume pas à son esthétique. C’est d’ailleurs le cas ici. Mais quand même…
De l’essence relative des qualités
A défaut de progresser autant que je le souhaiterais dans la compréhension et l’expression orale, je prends plaisir à observer les particularités de la langue chinoise. Ainsi de l’expression des qualités. Pour nous, on est gros, fort, petit… Eh ben, en chinois, cela ne peut pas se dire ainsi. D’abord, ils n’ont pas d’adjectifs qualificatifs, mais des verbes d’état qualificatif. Dà 大 (un homme qui étend les bras) est un verbe qu’on pourrait traduire par « être grand », kě 渴 par « avoir soif », etc. C’est évidemment une première différence. Mais il en est une autre plus surprenante. C’est que ces verbes qualificatifs sont relatifs et non pas absolus. Aussi, est on obligé d’ajouté un adverbe devant le verbe pour donner le sens de la qualité. 我很大, wǒ hěn dà, cela donne en traduction restituante approximative : « moi » « très » « être grand » (qu’on doit traduire en français par « je suis grand » et non pas « je suis très grand ») ou 我不大, wǒ bù dà, « moi » « pas » « être grand » (« je ne suis pas grand »). Si je dis simplement 我大, wǒ dà, « moi » « être grand », c’est comme si j’exprimais une réserve sur cette grandeur.

Cela signifie donc qu’est inscrit dans leur langue la relativité des qualités. C’est elle qui est première et qu’il faut doper dans un sens ou un autre. Cette relativité essentielle vient compléter ce que j’ai écris plus haut à propos des mouvements du Yin et du Yang : on passe d’autant plus facilement du Yin au Yang et du Yang au Yin que les qualités dont ils sont les vecteurs ne s’opposent pas frontalement. Ainsi dans l’image qui illustre ce texte, ce père est grand et son fils petit. Mais cela n’est que provisoire. Qui sait s’il ne deviendra pas plus grand que son géniteur ?
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir d’adjectif qualificatif, diminue le champ d’application du verbe être, qui existe aussi en chinois. Son omniprésence chez nous n’a peut-être pas été étrangère au développement de l’ontologie dans la philosophie européenne, et sa faible occurrence en chinois, son absence dans la pensée chinoise ?