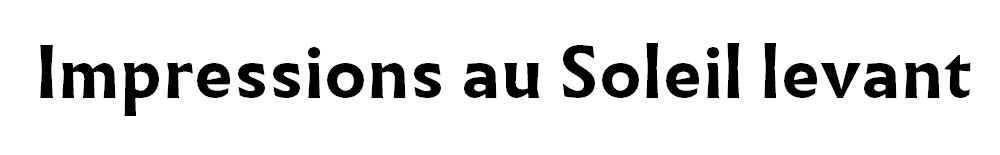
Voici un 5° envoi découpé en 7 séquences. Bonne lecture !
L’extraordinaire vitalité des banyans
J’ai profité des vacances du nouvel an chinois pour me rendre quelques jours dans le sud de l’île où il fait meilleur qu’à Taipei (pei = nord). A Tainan (nan = sud), une maison de maître a été laissé à l’abandon quelques années. Les banyans s’y sont installés et ont envahi ses murs, son toit… Du coup, cette « maison arbre » est devenue une curiosité touristique (photos 1 à 3) !



Les banyans sont des arbres magnifiques, immenses, altiers. Ils ont la capacité de produire des piliers qui leur permette de s’étendre sur de grandes surfaces. Leurs racines pénètrent le sol et courrent à sa surface. Elles secrètent un acide qui dissous le calcaire et leur permet de s’installer sur des roches (ou des briques…). Des vrais costauds !
Ces arbres me fascinent et me réjouissent. Ils sont une sorte de preuve vivante que la nature ne se laissera pas faire et saura s’adapter et transformer le monde qui vient.


Des temples, usines à papier
La religion populaire chinoise ne cesse de m’intriguer. Partout dans l’île, on trouve des temples : des tous petits que l’on découvre au coin d’une rue ou d’immenses qui drainent les foules. Plus que l’architecture, c’est ce que font les gens à l’intérieur qui m’y attire. J’observe plus que je ne comprends. C’est comme un jeu. Cette position d’observateur ne gêne d’ailleurs personne. Les gens se laissent prendre en photo sans jamais en prendre ombrage – sinon évidemment, je n’en ferai pas.
Dans ces temples, les divinités sont très nombreuses et pas jalouses ; elles cohabitent sans difficulté les unes avec les autres. Certaines appartiennent au panthéon taoïste, d’autres au bouddhisme, d’autres au confucianisme. Dans un grand temple, elles peuvent être ainsi plus d’une centaine,serrées les unes contre les autres. On est bien loin de la passion exclusive exigée par Yahvé, le Christ ou Allah !
Vu de l’extérieur, cela donne l’impression d’une religion de rituels plus que de doctrine. Du coup, je ne sais d’ailleurs pas quel nom donner à ceux qui s’y adonnent : des croyants ? des fidèles ? Des pratiquants ? Des observants ? Le rituel que je présente ici est l’un des plus étonnant. Les gens achètent des liasses de papiers colorés et illustrés qu’ils donnent en offrande ou qu’ils font brûler dans de grands et souvent jolis fours. Les étals de vente de ces papiers sont nombreux dans les rues qui conduisent au temple ou dans le temple lui-même.
[Pour visualiser le diaporama en grand format, cliquez sur la première photo]
Ces papiers sont une « monnaie votive » offerte aux défunts afin qu’ils puissent en avoir usage au royaume des morts qui doit donc avoir quelque rapport avec le nôtre. J’imagine que les fumées qui s’échappent du papier qui brûle ont ce caractère évanescent et rapidement invisible qui les font à l’image des fantômes ou âmes des défunts.
Mais cette coutume a pris un tour industriel qui n’est guère favorable au bilan carbone des temples. Aussi les fumées des fours sont-elles récupérées par une tuyauterie en inox. Est-ce là que les âmes mortes vont maintenant les chercher pour vivre mieux là où elles sont ?

A Foguang Shan, le musée du Bouddha
Lorsque je suis arrivé au musée du Bouddha, près de Kaohsiung, je me suis d’abord cru à Bouddhaland. Mais contrairement à la religion populaire chinoise, le bouddhisme a un fonds doctrinal explicite, riche et culotté comme une vieille pipe. Et si le fondateur du Monastère et du Centre d’étude de Foguang Shan, un maître de la tradition Chan (Zen), a ouvert juste à côté ce musée, son intention était prosélyte : attirer la foule et l’éclairer de la lumière du Bouddha (ce que signifie Foguang). Dans cette immense espace, à côté du folklore et des marchands du temple chargés d’attirer le chaland, il existe quelques belles salles de méditation et de recueillement où toute photo est proscrite et des expositions qui présentent l’enseignement du Bouddha.
N’empêche. Il est amusant de voir un moine en tenue safran conduire un petit train automobile pour aider les touristes à monter jusqu’au musée !
Le chinois traduit en français peut rester du chinois…

Les traductions automatisées vers le français sont souvent incompréhensibles. Le T shirt de cette jeune fille en donne une illustration : « La vie bonheurs est partout 1980 Merei beaucoup ». Il est facile de corriger les fautes d’orthographe, beaucoup moins de comprendre le message ! Pourtant, en chinois, il devait bien y en avoir un…
Ni passé, ni futur !
Ça n’a pas été la moindre de mes surprises. Les verbes en chinois sont invariables. Ils ne se conjuguent pas et il n’y a pas vraiment d’auxiliaire pour porter à leur place la flèche du temps. Le moment de joie passé en découvrant qu’il n’y avait donc aucune conjugaison à apprendre a fait ensuite place à de la perplexité. Comment fait-on alors ? Ce cher futur antérieur, comment l’exprime t’on ? En fait il existe de multiple manière de pallier cette absence que je suis loin de toutes connaître. Mais la plus simple évidemment, c’est de contextualiser le temps dans le propos : l’année dernière, hier, jeudi prochain, etc.
S’il n’y a pas de conjugaison, c’est parce que le chinois privilégie l’action, son degré d’avancement et les changements qui affectent les situations vécues. La logique qui prévaut, c’est celle de l’accompli et de l’inaccompli : l’action est-elle en cours ou achevée ? Elle est loin d’être la seule langue à utiliser ce procédé. Mais elle y ajoute une petite touche magique avec une particule « le » qu’elle écrit sobrement 了. Placée derrière un verbe d’action, elle indique que l’action est achevée, placée à la fin de la phrase, que la situation vient de changer : elle était comme ci, maintenant elle est comme ça. Ainsi, « Je suis fatigué » peut se dire Wǒ hěn lèi 我很累 ou bien Wǒ lèile 我累了, mais dans ce dernier cas, je mets l’accent sur le changement qui m’affecte : j’étais plein d’allant tout à l’heure, mais maintenant, je n’ai plus de ressort.

Cette attention au moment où les choses basculent, il est une œuvre antique chinoise qui la théorise : le yìjīng, 易经, un traité sur les mutations qui affectent la vie et sur la manière la plus adaptée d’y faire face (la photo d’illustration représente les 8 trigrammes de base dont les combinaisons aboutissent aux 64 mutations du traité). Cette particule magique,了, a t’elle joué un rôle d’incitation à la conception de cette œuvre d’un genre unique au monde, ou bien, à l’inverse, une langue se construit-elle à partir d’une philosophie de la vie sous-jacente
